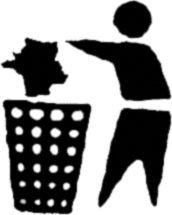Depuis maintenant près de deux mois, quatre jeunes hommes et femmes sont en détention «provisoire» à la maison d’arrêt de Labège, sans qu’aucune date ait jamais été avancée concernant leur remise en liberté. Et on retrouve dans leur « affaire » un scénario désormais bien rodé pour la police et l’institution judiciaire : d’abord la criminalisation des personnes arrêtées, au moyen de l’étiquetage « ultra-gauche » ; puis une détention « provisoire » qui s’éternise ; enfin, un prélèvement d’ADN dont le refus est sanctionné pénalement…
Le 14 novembre dernier, une centaine de gendarmes mobiles ont opéré une impressionnante rafle à Toulouse dans sept lieux d’habitation (pour la plupart des squats) et interpellé une quinzaine de personnes (dont une famille de sans-papiers) ; ils ont ensuite mis six d’entre elles en garde à vue. Ces personnes ont toutes nié les faits qui leur sont reprochés ; elles ont juste reconnu un engagement militant (pour la plupart depuis le lycée avec le mouvement anti-CPE) et ont refusé le prélèvement d’ADN. Quatre sont donc présentement en détention, une autre jeune femme a été inculpée mais placée sous contrôle judiciaire, et un jeune homme a été libéré mais en tant que « témoin assisté ».
Les arrestations intervenues à Toulouse entrent dans le cadre de l’« affaire de Labège » : le 5 juillet 2011, une dizaine de personnes non identifiables ont pénétré dans les locaux de la direction interrégionale de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ, organisme qui dépend du ministère de la Justice) à Labège, dans la banlieue de Toulouse. Ce groupe a déversé des excréments sur des ordinateurs et des bureaux, tagué quelques slogans sur des murs, et laissé sur place des tracts non siglés dénonçant l’accentuation permanente de la politique sécuritaire à l’encontre des mineur-e-s avant de se volatiliser quelques
minutes plus tard.
L’action visait donc clairement la ligne répressive de l’Etat – dénoncée par une partie des éducateurs eux-mêmes, notamment en 2002 lors de la création des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). En mai dernier, en effet, une révolte a éclaté à l’EPM de Lavaur, dans le Tarn. L’administration
pénitentiaire et la PJJ y ont répondu par l’intervention des équipes régionales et de sécurité (ERS), des mesures d’isolement, des conseils disciplinaires et des transferts. La PJJ a alors déclaré qu’une partie des
jeunes détenus étaient « irrécupérables », et elle a demandé « plus de sécurité, un profilage des détenus et une reconnaissance de la pénibilité [du] métier ». Au début de l’été, le Parlement s’apprêtait de plus à adopter une refonte de l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, comprenant entre autres la création d’un tribunal correctionnel pour les récidivistes de plus de 16 ans en ce qui concerne des délits passibles d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Toujours est-il que l’action de Labège s’est déroulée sans violence – hormis un bref lâcher de bombe lacrymogène en direction d’un membre de la PJJ quand celui-ci a arraché le sac à dos d’un membre du groupe (il n’a eu aucun arrêt de travail et n’a pas porté plainte). Le procureur de la République, qui s’est déplacé sur les lieux avec le préfet le lendemain, a de plus remarqué lui-même que l’action menée « n’a[vait] finalement fait que peu de dégâts ».
D’où l’évidente disproportion de l’opération lancée quatre mois plus tard par des forces de l’ordre surarmées pour procéder à une vague de perquisitions et d’arrestations à Toulouse, sur la base du sac laissé sur place à Labège (si ce sac semble bien appartenir à un des prévenus, ce dernier affirme l’avoir
perdu lors de son déménagement en juin dernier).
A la fin de leur garde à vue, les lourdes inculpations que le juge a prononcées à l’égard de cinq personnes ont été les suivantes :
« – Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou de dégradations de biens ;
– violence commise en réunion sans incapacité ;
– dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. »
En dépit du fait que ces personnes n’appartiennent à aucune organisation et que l’action de Labège n’a pas été revendiquée, l’étiquette « ultra-gauche» qui a été collée sur leur dos et sur leurs dossiers, et que les médias ont reprise, a suffi à les criminaliser (l’ordonnance de placement en détention provisoire concernant un des prévenus affirme ainsi que celui-ci « reconnaît son appartenance à un mouvement d’extrême gauche, lequel est à l’origine des faits reprochés comme en attestent les tracts laissés sur place » ; or le terme d’« ultra-gauche » qui lui a été attribué pendant la garde à vue ne représente en rien une organisation). Et ce malgré l’absence de preuves jusqu’à ce jour, car l’instruction court toujours. De même que l’« appartenance à la mouvance anarcho-autonome » et d’autres qualificatifs de ce genre, l’étiquetage « ultra-gauche » sert ainsi depuis des années maintenant à créer un véritable délit d’opinion.
Par ailleurs, le refus opposé par les « inculpé-e-s de Labège » à un prélèvement d’ADN va leur valoir un procès, début mai, quoique cet ADN leur ait de toute façon été prélevé contre leur gré en garde à vue (sur les gobelets et couverts utilisés pour se restaurer durant ce laps de temps). Les avocats des inculpé-e-s se sont à une exception près abstenus de faire appel de la mise en détention, sur l’idée que le juge attend les résultats des tests pour décider de leur libération ou non ; mais on peut sérieusement en douter, après sept semaines de détention. Il est bien plus probable que ces résultats sont déjà connus, et qu’il s’agit plutôt pour le juge de laisser mariner toute cette jeunesse en prison, dans l’espoir de la faire craquer et avouer ou du moins « coopérer » (tout en observant qui se mobilise pour les soutenir, aussi et bien sûr, afin d’alimenter les fichiers et de trouver d’autres « coauteurs » de l’action incriminée), surtout si le résultat des tests n’a pas « démontré » la culpabilité des inculpé-e-s.
Rappelons que le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a la particularité d’être alimenté de force – le prélèvement est « juridiquement contraint » car, en garde à vue, l’officier de police
judiciaire a l’obligation d’informer le prévenu qu’il peut refuser ce « prélèvement biologique », mais en ajoutant aussitôt que « ce refus constitue un délit », et pas des moindres, puisque le code pénal prévoit jusqu’à un an ferme et 15 000 euros d’amende. Une situation kafkaïenne, étant donné le nombre de gens qui, relaxés du délit pour lequel on leur demandait leur ADN, demeurent poursuivis pour le délit de refus de prélèvement ; c’est qui plus est un « délit continu » : tant que l’on persiste dans son refus, on peut être convoqué à tout moment pour une nouvelle demande de prélèvement. Cette situation fait que certains ont porté leur cas devant la Cour européenne des droits de l’homme (voir http://www.slate.fr/story/47639/adn-fichiers).
Par les détentions « provisoires » qui s’éternisent, l’institution judiciaire entre également, et une fois de plus là encore, en complète contradiction avec la « présomption d’innocence » censée former le socle
de la justice française. Il n’est que de voir la population des prisons, composée pour moitié de prévenu-e-s dans l’attente d’un procès qui peut avoir lieu deux ou trois ans plus tard. Ou se rappeler l’expérience pénitentiaire de Julien Coupat (plus de six mois) ; et, encore plus fort, celle des six Parisiens qui sont traduits en justice en mars prochain : entre sept et treize mois de « provisoire », avec un placement sous contrôle judiciaire ensuite (leurs quatre affaires ont été rassemblées sous le prétexte d’une même « association de malfaiteurs dans un but terroriste » – voir notamment l’article de Camille Polloni paru sur Inrocks.com le 19 janvier 2011 :
http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/t/57636/date/2011-01-19/article/lultragauche-nouvelle-menace-pour-la-police-antiterroriste/).
Depuis leur arrivée à la maison d’arrêt, la situation des « inculpé-e-s de Labège » n’a pas évolué : chaque fois que le tribunal a dû réexaminer leur incarcération, il a choisi de les maintenir en prison.
Les motifs qu’il invoque demeurent :
– « d’empêcher une concertation frauduleuse avec les complices », alors que les deux jeunes femmes ont été enfermées dans la même cellule et que les deux jeunes hommes ont effectué leurs promenades ensemble durant leurs premiers jours à Muret
;
– « d’empêcher une pression sur les témoins ou victimes », alors que dans l’action de Labège il n’y a pas eu de victimes et qu’aucun témoin n’est en mesure d’identifier ses responsables.
– « de prévenir le renouvellement de l’infraction », alors qu’il ne s’agit pas de récidivistes mais de « primo-délinquants », selon le jargon judiciaire.
L’attitude du tribunal à l’égard du seul prévenu qui a fait appel de sa mise en détention puis, débouté, a déposé une demande de remise en liberté montre bien que pour ce tribunal la culpabilité des inculpé-e-s est acquise.
Lors de l’appel, qui s’est déroulé en présence de ce prévenu et dont l’audience était publique, la juge a lu le texte de l’ordonnance de placement en détention provisoire et s’est s’exclamée lorsqu’il a été question de la PJJ : « C’est parfaitement hilarant, quand on connaît le dévouement du personnel de la PJJ ! » ; peu après, c’est son collègue qui s’est écrié, à la mention que les inculpé-e-s avaient refusé le prélèvement d’ADN par conviction politique, qu’il ne voyait « vraiment pas » comment on pouvait associer les termes « ADN » et « politique »… Après quoi, ce tribunal a demandé au prévenu s’il avait quelque chose à ajouter, et, relevant qu’on le qualifiait d’« ultra-gauche » dans l’ordonnance de mise en détention, il a
voulu savoir ce que le tribunal entendait par là en précisant qu’il était prêt à en débattre puisqu’il n’appartenait à aucune organisation. Autrement dit, il a répondu sans arrogance, mais sans se laisser démonter ni baisser la tête dans l’attitude attendue de repentance, partant de culpabilité admise.
Inacceptable, pour le tribunal – d’où le commentaire suivant, à la fin de l’arrêt de la cour d’appel le maintenant en détention : « Son attitude laisse présumer qu’il agit délibérément même s’il conteste formellement les faits.»
La demande de remise en liberté s’est soldée quant à elle en deux temps trois mouvements dans le bureau du juge : celui-ci a campé sur ses positions, en motivant son refus de remettre l’inculpé en liberté par les arguments précédemment utilisés, mais en ajoutant cette fois qu’il ne croyait pas à la promesse
d’embauche obtenue pour six mois à compter du 2 janvier 2012. Autrement dit, après avoir en novembre invoqué un manque de « garanties de représentation » pour mettre cet inculpé en détention (au prétexte qu’il n’avait pas repris une inscription à la fac en septembre mais s’était inscrit à Pôle emploi), cette proposition de travail n’a pas davantage satisfait le tribunal : il a laissé en prison cet inculpé malgré un casier judiciaire vierge, l’existence d’un logement loué et de revenus (modestes mais réels), et sans avancer la moindre preuve corroborant les accusations portées à son encontre.
On assiste ainsi, grâce aux innombrables lois sécuritaires adoptées depuis une dizaine d’années, à la criminalisation d’une certaine jeunesse radicalisée : selon ses besoins du moment, l’Etat réprime les jeunes de banlieue ou les « jeunes » en général, les « étrangers » ou les sans-papiers, les Roms, les «
anarcho-autonomes », les activistes politiques ou les participants à des mouvements de la contestation sociale.
Les milieux tour à tour en butte à la répression se trouvent à la merci du pouvoir. D’une part, parce que la détention « provisoire » peut être prolongée, selon le bon vouloir des juges, pendant des mois et des mois voire des années – une situation qui a plusieurs fois incité la Cour européenne des droits de l’homme à critiquer la France là-dessus aussi et à lui demander de revoir cette pratique. D’autre part, parce que le refus de prélèvement d’ADN est sanctionné pénalement et de façon répétitive.
Pareille situation démontre, s’il en était besoin, l’urgence de la contrer par l’affirmation d’une solidarité concrète envers les personnes en butte à la répression parce qu’elles contestent le système capitaliste et son organisation sociale. Seule la manifestation de cette solidarité peut leur éviter la marginalisation dans laquelle l’Etat cherche à les piéger et vers laquelle la répression tend trop souvent à les pousser. Il faut dénoncer haut et fort la perversité d’une détention « provisoire » qui revient à faire exécuter une
peine avant même qu’un jugement ait été rendu – d’autant plus que semblable procédé anéantit toute possibilité de relaxe lors du procès : quand celui-ci finit par avoir lieu, le tribunal condamne à une peine couvrant la durée de la préventive, afin de ne pas être attaqué en justice pour détention arbitraire.
Alors, décidément, ne laissons plus faire !